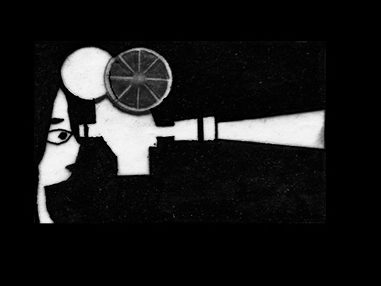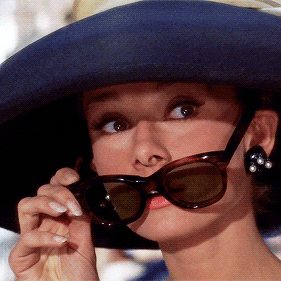Pourquoi cette interview ?
Avec Mama, présenté à Cannes 2025, la réalisatrice israélienne Or Sinai signe un premier long-métrage puissant, inspiré d’une expérience intime : l’arrivée d’une travailleuse migrante dans la maison de ses parents. De cette rencontre naît une œuvre bouleversante, à hauteur de femme, filmée au plus près du corps, du désir et du silence de Mila — une aide-soignante polonaise confrontée à la distance, à l’absence et à l’indifférence sociale.
En cinq questions, Or Sinai interroge nos stéréotypes, met à nu les hiérarchies invisibles, et compose une fresque sensorielle et politique. Un cinéma du regard qui place la subjectivité féminine au cœur de chaque plan, de chaque décision esthétique. Et qui fait de Mama bien plus qu’un récit social : une odyssée intérieure.
Mama place le regard féminin au centre – comment avez-vous construit la subjectivité de Mila tout au long du film ?
J’ai commencé à écrire cette histoire lorsqu’une aide-soignante migrante est venue travailler chez mes parents. Un bulldozer a creusé un trou profond dans le sol pour aménager une chambre souterraine destinée à cette nouvelle femme dans leur maison. Dès les premiers jours, j’ai été frappée par la dynamique étrange qui s’installait entre mes parents et cette femme soudainement intégrée à leur quotidien, sans en faire réellement partie. C’était comme s’ils jouaient tous une sorte de pièce muette.
Elle m’a tout de suite fascinée. Nous avons très vite découvert que nous avions presque le même âge, ce qui a facilité un dialogue direct entre nous. Elle m’a raconté sa famille restée au pays, mais aussi son amant « temporaire », une relation née de sa vie elle aussi temporaire, loin de chez elle. Ses récits m’ont profondément marquée et ont inspiré l’écriture du scénario. J’ai mené un travail de recherche approfondi sur ces femmes migrantes qui quittent leur foyer lointain et bâtissent des identités provisoires dans les foyers où elles travaillent.
Dès le début, c’est donc le point de vue de Mila qui m’a captivée et donné envie de raconter cette histoire. Je voulais que les spectateurs tombent amoureux d’elle, comme je suis tombée amoureuse des femmes que j’ai rencontrées.
Tout au long du processus, il m’a semblé essentiel que l’on vive le film de l’intérieur de Mila — qu’on suive son cheminement émotionnel. Le scénario a donc été entièrement écrit de son point de vue. Il n’existe pas une seule scène — pas même un instant — sans elle à l’écran. Cette logique s’est aussi traduite dans la mise en scène : la caméra reste toujours proche d’elle, permettant au public de ressentir chaque moment à travers son regard.
Qu’avez-vous voulu révéler ou remettre en question dans la manière dont la société regarde les femmes migrantes et
« invisibles » ?
Je voulais offrir un nouvel éclairage sur ces figures reléguées aux marges de la société. Lorsque j’ai rencontré Olga, la femme qui travaillait chez mes parents, j’ai pris conscience que moi aussi, j’avais des idées préconçues sur ce que pouvait être la vie d’une travailleuse migrante. Mais ses récits n’ont cessé de me surprendre et de déconstruire ces stéréotypes.
On a l’habitude de voir les femmes migrantes comme des figures sacrificielles, qui renoncent à leur vie pour leurs enfants mais ici, j’ai voulu raconter une histoire plus complexe.
Oui, Mila a en partie sacrifié sa vie. Mais elle a aussi conquis des espaces et des expériences qu’elle n’aurait jamais connus autrement. Elle subit, bien sûr, les injustices d’une hiérarchie sociale déformée, mais elle vit aussi une vie pleine de passion. Elle a une vie sexuelle, elle connaît le désir, le plaisir, la colère, l’espoir, comme n’importe qui. J’ai voulu défier cette tendance à rendre ces femmes invisibles en les réduisant à leur rôle fonctionnel. Mila n’est pas « seulement » une aide-soignante : c’est un être humain à part entière, avec des désirs, des contradictions et un monde intérieur. À travers son histoire, j’espère amener les spectateurs à considérer les femmes migrantes non comme des personnages secondaires dans la vie des autres, mais comme des héroïnes de leur propre récit.
Comment avez-vous utilisé la caméra et la mise en scène pour traduire le monde intérieur de Mila — son corps, son désir, sa résilience ?
Mila a quitté un univers familier, a changé de pays dans l’espoir de construire un avenir meilleur pour sa famille, guidée par sa conscience. L’environnement qu’elle choisit pour s’installer joue un rôle central dans le film, à la fois solution et source de conflit. Dans notre interprétation visuelle du scénario, nous avons cherché à souligner la manière dont Mila occupe l’espace, pour offrir au spectateur une expérience sensorielle et sincère, sans renoncer à une grammaire cinématographique capable de transmettre en même temps des émotions, des informations et des détails subtils, tout en évitant autant que possible les gros plans répétitifs.
Nous avons privilégié des focales assez larges et mis en scène des séquences très mobiles, afin de faire évoluer les plans dans une diversité de profondeurs de champ. Cette approche permet à Mila de se fondre dans son environnement ou de s’en détacher, selon les moments, en se rapprochant de la caméra et en laissant au spectateur l’espace pour interpréter ses émotions.
Quelle scène incarne selon vous le mieux la puissance du regard féminin dans Mama ?
Pour moi, la séquence la plus forte se déroule à l’hôpital. Je ne dévoilerai pas les détails pour ne pas gâcher l’expérience. Ce que je peux dire, c’est qu’elle réunit trois femmes dans une forme de jeu silencieux. Chacune y participe à contrecœur, faisant de son mieux face à des circonstances impossibles, et pourtant, cela aboutit à un effondrement profondément douloureux.
Mila, l’héroïne, se retrouve confrontée à un écart violent entre ses attentes et la réalité, ce qui la pousse à commettre un acte extrême impliquant sa fille. À ce moment-là, elle utilise sa propre féminité, et celle de sa fille, comme un levier pour parvenir à ses fins.
Quelle réaction de spectatrices vous a le plus marquée ?
Ce qui m’a le plus frappée, c’est la division très nette que nous avons observée chaque fois que nous projetions le film à un public féminin. Il y a un premier groupe de femmes qui s’identifie profondément à Mila — elles la comprennent, elles ressentent sa douleur. Et puis un autre groupe qui est en colère contre elle, qui pense qu’elle va trop loin, qu’elle fait subir des choses terribles à sa fille.
Je trouve passionnant d’ouvrir un espace de dialogue entre ces deux regards. Et ce dont je suis le plus fière, c’est d’avoir créé un personnage complexe. Mila n’est ni simplement « bonne » ni simplement « mauvaise » — elle est humaine. C’est précisément cette complexité morale et émotionnelle que je voulais explorer.
La réaction la plus émouvante est venue d’Olga elle-même, la femme qui a inspiré cette histoire. Elle a été profondément touchée et bouleversée par le film. Elle a eu le sentiment que son histoire était enfin racontée — et cela a été très fort pour moi. Ce fut un moment de reconnaissance et de validation mutuelle, et cela m’a rappelé pourquoi j’ai fait ce film : pour donner la parole à ces femmes dont la vie reste trop souvent invisible ou mal comprise.
Bande-annonce