Le wax sous toutes ses coutures : une exposition éclatante au Musée de l’Homme
© MNHN – A. Iatzoura
© MNHN – A. Iatzoura
© MNHN – A. Iatzoura
Le wax évoque tout de suite les couleurs de mon enfance. Née à Abidjan, j’ai grandi à Libreville et vécu plus tard à Brazzaville. Venir à cette exposition allait donc de soi.
Ce tissu de coton aux couleurs flamboyantes et aux motifs évocateurs, est bien plus qu’une simple étoffe. Il est un langage, un marqueur identitaire et un témoin de l’histoire des circulations entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.
L’exposition WAX au Musée de l’Homme, du 5 février au 7 septembre 2025, nous plonge dans l’histoire et la résonance culturelle de ce textile devenu incontournable.
Il s’invite régulièrement dans la haute couture, se décline en accessoires du quotidien, investit les galeries d’art et devient même sujet de bande dessinée, comme en témoigne Wax Paradoxe de Justine Sow, roman graphique qui accompagne l’exposition.
Rencontres avec Thandiwe Muriu et Justine Sow
Un tissu aux origines métissées.
Né au XIXe siècle d’une industrialisation européenne du batik indonésien, il a été intégré aux cultures d’Afrique de l’Ouest, au point d’en devenir un symbole identitaire.
Cette histoire, marquée par les influences croisées de plusieurs continents, est l’un des fils conducteurs de l’exposition.
On y apprend ainsi comment, au milieu du XIXe siècle, des soldats ghanéens appelés « Belanda Hitam » (« Hollandais noirs » en malais) recrutés de force dans l’armée coloniale néerlandaise revenus de Java ont introduit ces tissus imprimés sur leur continent, suscitant un véritable engouement auprès de la population locale.
Ce sont ces influences qui ont ensuite été récupérées et industrialisées par les manufactures européennes, en particulier Vlisco, qui a adapté la technique pour produire ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de wax.
Un commerce florissant s’est alors développé, porté par des figures emblématiques comme les Nana Benz du Togo (photo ci-dessous prise à l’exposition), ces femmes d’affaires visionnaires qui, dès les années 1960, ont fait du wax un produit de luxe et un élément de distinction sociale.
Nana Benz du Togo (photo prise à l’exposition)
Le wax, un tissu qui parle
Le pagne en wax n’est jamais anodin : il raconte une histoire, transmet un message. Chaque dessin porte une signification qui peut être affective, politique ou sociale.
Certaines références sont mondialement connues. Le motif « Chérie ne me tourne pas le dos », souvent porté par des femmes mariées en signe d’avertissement à leur conjoint, ou encore le « Sac de Michelle Obama », inspiré du style vestimentaire de l’ancienne First Lady et devenu un best-seller en Afrique de l’Ouest.
Le vêtement est social, facteur d’émancipation des femmes, un vecteur de communication non verbal, un support d’expression individuelle et collective.
Entre art et contestation
Mais le wax, longtemps perçu comme un textile de fierté et d’appartenance culturelle, fait aussi l’objet de débats.
Symbole de l’identité africaine ou vestige du colonialisme ?
Des œuvres du plasticien béninois Romuald Hazoumé aux photographies d’Omar Victor Diop, en passant par les créations textiles du styliste malien Lamine Badian Kouyaté (XULY.Bët), le wax est revisité, réinterprété, parfois détourné pour dénoncer les dérives du consumérisme et les inégalités sociales.
Entre tradition et futur.
Le marché du wax est aujourd’hui dominé par les grandes manufactures. Les productions asiatiques bon marché inondent les marchés africains. Mais de jeunes créateurs africains, soucieux de valoriser un savoir-faire local, réinventent le tissu en privilégiant des méthodes de fabrication durables et respectueuses de l’environnement.
Cette exposition, voyage dans le temps et dans l’espace continue de questionner. Il a encore de beaux jours devant lui.
Le wax continue d’évoluer, témoignant de son incroyable capacité d’adaptation. Il est mémoire, revendication, art et héritage.
Commissaires scientifiques.
Soloba Diakité, historienne de l’art, spécialiste du patrimoine textile africain.
Cindy Olohou, historienne de l’art et critique d’art contemporain.
Manuel Valentin, anthropologue des patrimoines matériels, responsable scientifique des collections d’anthropologie culturelle du Muséum.
Commissariat d’exposition.
Marie Merlin, cheffe de projet, muséographe.
Du 5 février au 7 septembre 2025
17 Place du Trocadéro, 75016 – M° Trocadéro (6/9)
Du mercredi au lundi de 11h à 19h- fermé le mardi-
Tarif : 15 € / TR : 12 € / Gratuit – 26 ans
Plus d’informations ici
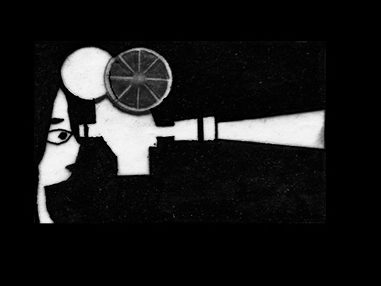





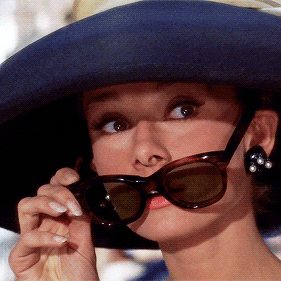
2 réponses
Cette exposition sur le Wax a l’air trop bien ! je vais y aller ! Bravo pour l’interview !
Merci ! Je vous la recommande !